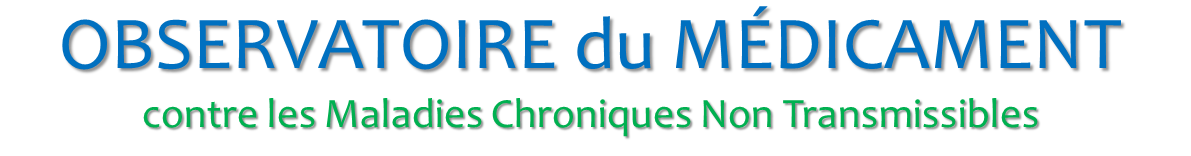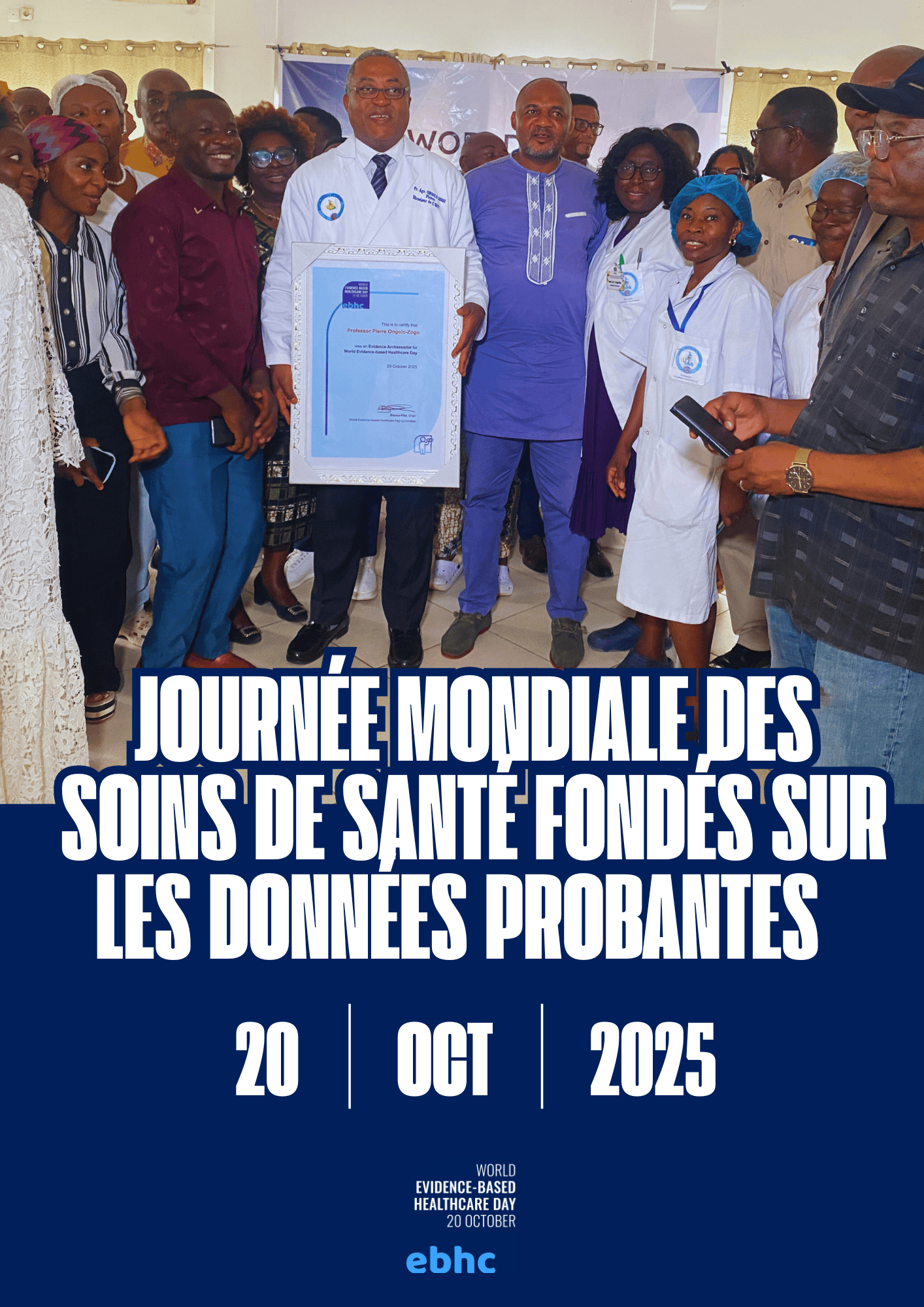
Vers une éthique de la communication sanitaire fondée sur les données probantes : réflexions et perspectives camerounaises
Dans le cadre de la Journée mondiale des soins de santé fondés sur les données probantes (EBHC Day 2025), célébrée le 20 octobre, le Centre pour le Développement des Bonnes Pratiques en Santé, en partenariat avec COCHRANE Cameroun et E Base Africa, a coorganisé une édition exceptionnelle du Café Éthique au sein de l’Hôpital Central de Yaoundé.
Cette rencontre a constitué un espace de délibération scientifique et éthique autour d’un thème d’une pertinence stratégique : « Éclairer les patients, renforcer les communautés : enjeux éthiques et modalités pratiques de la communication sanitaire au Cameroun ».
Parmi les axes de réflexion explorés, plusieurs interrogations structurantes ont été soulevées :
- En quoi une communication claire, contextualisée et adaptée peut-elle renforcer la confiance des patients et améliorer les résultats cliniques ?
- Quels formats discursifs et niveaux de granularité informationnelle sont les plus pertinents dans le contexte socioculturel camerounais ?
- Quels repères éthiques doivent présider à la conception, à la diffusion et à la réception des messages sanitaires ?
- Comment articuler transmission de l’information et préservation de l’autonomie sans induire confusion ou surcharge cognitive ?
Au-delà de la dimension informative, la communication sanitaire a été reconnue comme un acte éthique fondamental, structurant les pratiques de soin et les dynamiques communautaires. L’événement a permis de dépasser une conception monolithique du savoir médical, en valorisant son caractère relationnel, évolutif et contextuel. Le savoir en santé y a été envisagé comme une construction intersubjective, située au croisement des interactions entre individus, institutions et environnements, et mobilisable comme levier de transformation des pratiques cliniques et des politiques publiques.
Dans ce cadre, l’intervention du Dr Guy Sadeu Wafeu, représentant de Cochrane Cameroun, a proposé une structuration analytique en cinq axes :
- Les fondements de la pratique des soins fondés sur les données probantes (EBHC) ;
- Les objectifs et enjeux de la Journée mondiale EBHC ;
- Les spécificités contextuelles justifiant l’importance de cette approche pour le Cameroun ;
- Les principes directeurs d’une communication collaborative des savoirs ;
- Les initiatives locales illustrant la dynamique de co-construction des connaissances.
L’argument central repose sur une exigence épistémologique et éthique : les décisions en santé doivent être éclairées par les meilleures données disponibles, c’est-à-dire des informations actuelles, valides, pertinentes et scientifiquement fondées. À titre illustratif, plusieurs questionnements cliniques ont été mobilisés pour démontrer la portée de cette approche :
- Les modifications du mode de vie peuvent-elles constituer une alternative thérapeutique suffisante à la prescription immédiate d’antihypertenseurs dans les cas d’hypertension légère ?
- Quelle stratégie est la plus efficiente pour réduire la consommation de substances psychoactives chez les adolescents ?
- Les compléments alimentaires à base de calcium présentent-ils une efficacité démontrée dans le traitement de l’arthrose ?
Ces exemples traduisent la nécessité d’un recours systématique aux données probantes pour guider les choix thérapeutiques, orienter les politiques de santé et garantir des soins adaptés aux réalités locales.
La pratique fondée sur les données probantes s’articule autour de cinq étapes méthodologiques :
- Formulation d’une question clinique pertinente à partir d’une problématique initiale ;
- Acquisition des meilleures données disponibles ;
- Évaluation critique de la qualité, de la validité et de la pertinence des données ;
- Intégration des données probantes dans le processus décisionnel, avec optimisation du temps de décision ;
- Audit des étapes précédentes en vue d’une amélioration continue.
La Journée mondiale EBHC, instaurée en 2020 et célébrée chaque 20 octobre, poursuit les objectifs suivants :
- Sensibiliser à l’usage des données probantes dans la prise de décision ;
- Promouvoir la nécessité de données de haute qualité ;
- Encourager les discussions communautaires sur les décisions fondées sur les preuves ;
- Valoriser les contributions majeures dans le domaine.
Cette réflexion revêt une importance particulière pour le Cameroun, confronté à un déséquilibre structurel entre une charge de morbidité élevée et des ressources sanitaires limitées. Dans ce contexte, la communication collaborative des savoirs s’impose comme une exigence éthique et stratégique. Elle repose sur une conception du savoir comme entité dynamique, plurielle et orientée vers l’action, intégrant les données scientifiques, les préférences communautaires, l’expertise clinique, les contextes locaux et les expériences vécues.
Les formes de savoir mobilisables incluent :
- Le savoir explicite, consigné dans les protocoles et guides ;
- Le savoir implicite, issu de la pratique ;
- Le savoir tacite, intuitif et enraciné dans le vécu ;
- Le savoir autochtone, porteur de dimensions spirituelles, culturelles et territoriales.
Une communication collaborative authentique doit favoriser un échange créatif d’informations et d’expertises, s’appuyer sur une diversité d’outils – infographies, vidéos, podcasts, théâtre, récits – et garantir l’inclusion des voix marginalisées ainsi que la valorisation des savoirs autochtones. Elle doit enfin promouvoir une co-production communautaire des connaissances, en vue de bâtir un système de santé plus équitable, plus pertinent et plus proche des réalités locales.
Les étapes d’une contribution effective à cette dynamique incluent :
- L’identification des problèmes de santé prioritaires ;
- La formulation de questions cliniques pertinentes ;
- La production ou la recherche de données probantes ;
- L’évaluation critique des sources ;
- L’intégration interdisciplinaire des savoirs ;
- L’application dans la pratique clinique ou les politiques publiques ;
- L’évaluation des impacts sur la santé des populations.
Parmi les initiatives locales exemplaires :
- Cochrane Cameroun : lancé en juillet 2021, diffusion mensuelle de synthèses probantes, services de priorisation et de synthèse sur demande.
- Cameroon Consumer Service Organization (CamCoSO) : vulgarisation via réseaux sociaux, mentorat citoyen, adhésion Cochrane pour 15 participants (juillet-septembre).
- eBASE Africa : approche interactive fondée sur les traditions africaines (théâtre, danse, récits), pour une communication engageante et culturellement ancrée.
Le récit comme vecteur stratégique de traduction des données probantes et de transformation comportementale : L’expérience Tori Dey – eBASE Africa
Lors de la session dédiée à la communication collaborative des savoirs dans le cadre de l’EBHC Day 2025, Dr Ngem Bede Yong, point focal JBI et responsable des programmes santé au sein d’eBASE Africa Cameroun, a présenté une contribution magistrale intitulée : « Le récit comme outil de changement de comportement et de traduction des données probantes : L’expérience Tori Dey eBASE Africa ». Cette intervention, articulée en six axes analytiques, a proposé une reconfiguration épistémologique et opérationnelle du rôle du récit dans les stratégies de communication sanitaire.
1. Justification du recours au récit : combler l’écart entre science et réception sociale
Malgré l’abondance de la production scientifique, les données probantes peinent à atteindre les publics cibles ou à susciter une résonance significative. Les modalités classiques de diffusion, souvent décontextualisées et dénuées de charge émotionnelle, échouent à induire une appropriation durable. Le récit, en tant que dispositif narratif fondé sur les données probantes, permet de transposer la rigueur scientifique dans des expériences humaines accessibles, mobilisant simultanément les dimensions rationnelles et affectives nécessaires à la transformation comportementale. Chez eBASE Africa, cette approche constitue une stratégie communicationnelle à part entière, visant à réduire l’asymétrie informationnelle par une articulation entre éducation et divertissement.
2. Fondements conceptuels : la métaphore des deux rivières
La métaphore des deux rivières illustre la confluence entre :
· La rivière du savoir scientifique : revues systématiques, données validées, méthodologies rigoureuses ;
· La rivière des récits humains : vécus, émotions, cultures, représentations.
Leur jonction donne naissance à une communication collaborative des savoirs, fondée sur le principe d’Ubuntu « Je suis parce que nous sommes » et conférant aux données probantes une voix humaine, contextualisée et partageable.
3. Le cadre méthodologique Tori Dey : sept étapes structurantes
Le modèle Tori Dey, développé par eBASE Africa, propose une séquence opérationnelle en sept phases :
1. Identification du thème narratif ;
2. Diagnostic communautaire ;
3. Exploration de la rivière scientifique ;
4. Formulation des énoncés probants ;
5. Co-construction des récits ;
6. Diffusion via la rivière des histoires ;
7. Évaluation des changements induits.
Ce cadre favorise une intégration dynamique entre savoirs scientifiques et savoirs communautaires, dans une logique de co-production et d’appropriation partagée.
4. Communication collaborative des savoirs : principes d’action
La mise en œuvre de cette approche repose sur plusieurs principes structurants :
· Les communautés deviennent co-productrices des connaissances ;
· Les professionnels de santé agissent comme facilitateurs du dialogue, et non comme transmetteurs unidirectionnels ;
· Les séances de narration instaurent des espaces de rencontre entre recherche et vécu ;
· Un triangle de confiance se construit entre chercheurs, cliniciens et communautés ;
· Cette dynamique favorise la compréhension mutuelle et la décision partagée, cœur du paradigme EBHC 2025.
5. Étude de cas : adoption du vaccin pentavalent
Une application concrète de cette approche a été illustrée par une initiative visant à améliorer l’adoption du vaccin pentavalent chez les enfants de moins de cinq ans :
· Renforcement de la confiance communautaire par l’implication des leaders locaux ;
· Formation des agents de santé aux techniques de communication contextualisée ;
· Collecte et analyse rigoureuses des données pour identifier les zones de résistance ;
· Utilisation de canaux variés (églises, maisons de réunion, SMS) pour diffuser les messages ;
· Mise en œuvre de critères d’audit incluant la disponibilité des supports, la planification des causeries, l’éducation des mères et le suivi des enfants non vaccinés.
6. Implications pour les politiques et les pratiques
L’expérience Tori Dey appelle à une reconfiguration des cadres institutionnels de communication sanitaire :
· Intégration du récit dans les politiques nationales de traduction des connaissances ;
· Promotion d’une communication multilingue et culturellement ancrée ;
· Développement de la compétence narrative dans la formation des professionnels ;
· Évaluation de la résonance, de la confiance et du changement comportemental, au-delà des indicateurs classiques de portée ;
· Renforcement des partenariats entre chercheurs, communicateurs et communautés.
Appel à l’action
« Lorsque la science se raconte à travers les gens, les décisions en santé deviennent partagées, dignes de confiance et durables. »
Le récit, en tant que vecteur d’inspiration et de transformation, permet de transcender les barrières épistémiques et sociales. L’expérience d’eBASE Africa démontre que l’addition des données probantes et de l’expérience vécue constitue un catalyseur puissant du changement.
Cette circonstance solennelle a offert au comité du World Evidence-Based Healthcare Day l’opportunité de conférer au Professeur ONGOLO ZOGO Pierre une distinction éminente, en le certifiant en qualité d’Evidence Ambassador. Par cet acte, le comité a reconnu la portée exemplaire de son engagement en que principal promoteur du Café Éthique, espace singulier et hautement estimé de délibération intellectuelle, consacré à l’exploration méthodique des savoirs, à l’analyse critique approfondie et au dialogue éthique structuré.
Ce lieu, désormais emblématique dans le paysage camerounais de la réflexion en santé, se distingue par sa vocation à articuler rigueur scientifique, lucidité morale et pluralité des perspectives, autour des enjeux complexes qui traversent la pratique des soins. La reconnaissance accordée au Professeur ONGOLO ZOGO Pierre consacre ainsi une œuvre intellectuelle et institutionnelle qui fait du Café Éthique un véritable laboratoire de pensée, au service d’une médecine éclairée, humaniste et fondée sur les meilleures données disponibles
Le lien d’écoute du podcast relatif à cette édition est désormais accessible à travers le lien suivant. : https://youtu.be/16Dezdxd7TM?si=7zVjMA1859VXRpVa