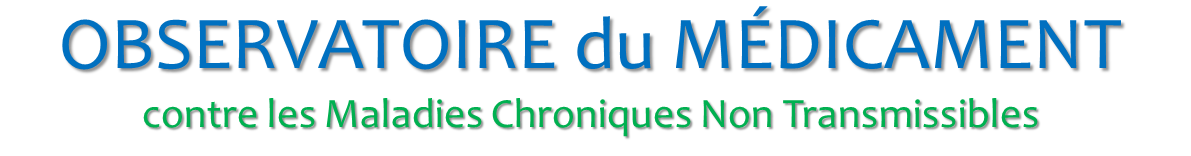Contexte, enjeux et justification
En guise de rentrée pour l’année 2025, le café éthique de l’Hôpital Central de Yaoundé rendu à sa 22ième édition, a choisi de discuté des considérations éthiques de la médecine traditionnelle avec pour point d’ancrage la récente loi n°2024/018 du 23 décembre 2024 portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun
. Au menu des échanges, deux exposés présentant cette loi dans l’optique de faciliter sa compréhension ou son appropriation. Le premier identifiant ses caractères et le second étant axé sur ses enjeux, perspectives et innovations. En complément du menu, des réactions en termes d’observations, commentaires et questionnement sur :
- La prise en compte par la loi des aspects éthiques ;
- Le respect des pratiques et des croyances culturelles ;
- L’existence d’une hiérarchisation entre la médecine importée et la médecine dite patrimoniale ;
- La démarche de consentement éclairé dans la pratique de médecine traditionnelle (car il s’agit ici d’une pratique de soins souvent à caractère communautaire ou familial contrairement à la démarche individualiste de la médecine occidentale) ;
- La normalisation et la standardisation de la qualité et de la sécurité des soins ;
- Les échelles de valeurs qui seront appliquées dans la validation de l’aptitude à exercer la médecine traditionnelle ;
- Les aspects touchant au droit de la propriété intellectuelle ;
- Les questions autour de l’équité et de la sécurité en termes de responsabilité professionnelle s’exercent-elles à titre individuel ou à titre communautaire ;
- Les questions sur la confidentialité et la vie privée dans le cadre des soins préparés pour toute une communauté ou une famille.
Tel est le questionnement suscité par la nouvelle loi qui accorde désormais un statut à la médecine traditionnelle.
Mais au-delà et pour mener une réflexion un peu plus approfondie, c’est de bon droit, dans un contexte de modernisation et de mondialisation des cultures, de se questionner davantage sur : comment relever les défis y relatifs ? quels sont les enjeux les plus urgents, à court terme, à moyen terme ou à long terme ? les praticiens formés à la médecine occidentale sont-ils disposés à exercer en collaboration avec les acteurs patrimoniaux ?
Exposé N°1 – Note de lecture et commentaires sur la loi N°2024/0180 du 23/12/2024 portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun par Herve Blaise BELOMO O., Juriste publiciste et cadre d’appui au Centre pour le Développement des Bonnes Pratiques en Santé (CDBPS-H).
Au bout de cinq pages, l’auteur dresse un portrait de la loi objet des échanges ; duquel il ressort substantivement qu’elle intègre la pratique de la médecine traditionnelle dans le système de santé national. Elle met un accent particulier sur les considérations éthiques, exigeant le respect de la dignité et de la vie humaine, ainsi que la conformité aux normes internationales, régionales et nationales. La loi impose aux tradipraticiens de respecter un code d'éthique et de déontologie. En termes de hiérarchisation, bien que la médecine traditionnelle soit intégrée au système de santé, la loi semble accorder une primauté à la médecine conventionnelle, notamment en permettant aux tradipraticiens de référer des patients aux formations de médecine conventionnelle, mais pas l'inverse. Cela pourrait indiquer une supériorité perçue de la médecine conventionnelle sur la médecine traditionnelle.
De manière plus structurée, voici un résumé des points clés autour desquels s’articule la loi :
Objectif de la loi : contenu dans le chapitre premier qui fixe les dispositions générales, c’est celui d’encadrer l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun, intégrant ainsi cette pratique dans le système de santé national.
Structure de la loi : La loi est composée de 44 articles répartis en 7 chapitres, avec une répartition inégale des articles entre les chapitres.
Exercice de la médecine traditionnelle : Le chapitre 2, le plus volumineux, traite des principes et des modalités d'exercice de la médecine traditionnelle, mettant en avant les considérations éthiques et la conformité aux normes internationales.
Collaboration et contrôle : Le chapitre 3 aborde la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, ainsi que le contrôle des centres médicaux traditionnels.
Protection : Le chapitre 4 se concentre sur la protection des tradipraticiens, des bénéficiaires de leurs soins, et de la pharmacopée traditionnelle camerounaise.
Création de l’Ordre National des Tradipraticiens de Santé : Le chapitre 5 crée l'Ordre National des Tradipraticiens de Santé du Cameroun, chargé de promouvoir et de garantir le respect des règles d'éthique et de déontologie.
Sanctions : Le chapitre 6 énumère les infractions et les sanctions applicables aux tradipraticiens.
Dispositions diverses : Le chapitre 7 traite de la formation continue, de l'intégration de la médecine traditionnelle dans les formations sanitaires publiques, et des incompatibilités professionnelles.
Exposé N°2 – Comprendre la loi N°2024/0180 du 23/12/2024 portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun : enjeux, perspectives et innovations par l’Honorable Dr MENGUE MEZUI (Auteur et expert en médecine traditionnelle et santé publique) – travail présenté par le Dr TEMFACK.
Dans le document qu’il propose, l’auteur essaie de comprendre la loi dont il est question sous le prisme des enjeux, perspectives et innovations qu’elle présente. Il en ressort au titre :
Des enjeux
- L’importance culturelle et sociale : La médecine traditionnelle est une composante essentielle de l'identité culturelle camerounaise, renforçant les liens sociaux et participant à l'harmonie communautaire.
- Les défis majeurs : Le manque de standardisation, la surexploitation des ressources et la reconnaissance limitée de la médecine traditionnelle par rapport à la médecine moderne sont des défis importants à surmonter.
- L’impact économique : La médecine traditionnelle contribue à l'économie locale en générant des revenus pour les praticiens et en stimulant le commerce de plantes médicinales.
Des perspectives
- L’intégration dans le système de santé : La création de centres de médecine traditionnelle au sein des établissements publics vise à promouvoir une approche holistique des soins, combinant savoirs traditionnels et médecine moderne.
- La recherche scientifique et valorisation des savoirs : La collaboration entre chercheurs et tradipraticiens permet de transformer des savoirs ancestraux en solutions modernes, comme l'exemple de l'Artemisia annua utilisée contre le paludisme.
- La protection de la biodiversité : La loi encourage des pratiques de cueillette durable pour préserver les ressources naturelles nécessaires à la médecine traditionnelle.
Des innovations
- Le renforcement des cadres réglementaires : Des protocoles d'évaluation des remèdes et des sanctions strictes en cas de violations sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et protéger les patients.
- La sensibilisation et l’éducation : Intégrer la médecine traditionnelle dans les cursus universitaires et mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur ses bienfaits et ses limites.
- Les partenariats internationaux : Le Cameroun peut bénéficier de l'expérience de pays comme l'Inde et la Chine, qui ont réussi à intégrer leurs médecines traditionnelles dans les politiques nationales de santé.
Echanges, Contributions et Commentaires –
Les contributions et échanges ont été les suivantes :
Analyse comparative ou parallélisme entre la médecine traditionnelle africaine et la médecine traditionnelle telle qu’elle est pratiquée en occident et depuis plus d’un millénaire en chine : contrairement à ces dernières, la médecine traditionnelle africaine est à la traine. Qu’est-ce qui justifierait cette situation ?
La médecine traditionnelle : une médecine holistique – elle prend en charge le malade dans sa globalité.
Sur la question de la hiérarchisation entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle : il y a un besoin de rationalisation nécessaire à son existence et à sa connaissance dans un contexte où la médecine occidentale qui s’est « camerounisée » (parce que beaucoup plus structurée), devient paradigmatique à la médecine traditionnelle. Par contre dans un pays comme la suisse, les praticiens de la médecine conventionnelle peuvent référer un malade vers ceux de la médecine traditionnelle.
Perspective de la mise en place d’une médecine intégrale ou intégrative, qui va tenir compte de tous les aspects de l’être humain.
La médecine traditionnelle, une médecine complémentaire ; perspective d’une élaboration d’une stratégie pharmaceutique de développement de la médecine traditionnelle.